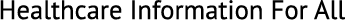Esther Duflo : « Plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la
trappe à pauvreté »
La lauréate du prix Nobel d’économie 2019 explique, dans un entretien au
« Monde », comment la méthode expérimentale qu’elle et ses colauréats
pratiquent depuis quinze ans a révolutionné la façon de faire de
l’économie.
Propos recueillis par Laurence Caramel
<https://www.lemonde.fr/signataires/laurence-caramel/> et Antoine Reverchon
<https://www.lemonde.fr/signataires/antoine-reverchon/> Publié le 03
janvier 2020 à 14h32 - Mis à jour le 04 janvier 2020 à 13h04
[image: La lauréate du prix Nobel d'économie 2019, Esther Duflo, à Paris,
le 16 décembre 2019.]
La lauréate du prix Nobel d'économie 2019, Esther Duflo, à Paris, le 16
décembre 2019. JEAN-LUC BERTINI POUR LE MONDEhttps://
www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/03/esther-duflo-il-faut-cesser-de-s...
Esther Duflo, chercheuse au Massachusets Institute of Technology (MIT), a
reçu le 14 octobre 2019 le prix de la Banque de Suède en sciences
économiques en l’honneur d’Alfred Nobel. Elle est ainsi la plus jeune
(46 ans), l’une des deux seules femmes (après Elinor Ostrom en 2009) et le
quatrième lauréat français (contre 62 Américains) de ce prix. C’est
l’originalité de ses travaux sur la pauvreté dans les pays en développement
que le jury du prix Nobel d’économie a voulu récompenser.
De quelle façon votre travail renouvelle-t-il la façon de faire de
l’économie du développement ?
Je travaille sur la vie économique des plus pauvres dans le monde. Notre
démarche au sein du Laboratoire d’action contre la pauvreté (Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab, J-PAL) a consisté à cesser de se poser de
grandes questions pas très définies, comme « quel type de croissance
faut-il promouvoir dans les pays en développement ? » ou « quelles sont les
“bonnes” politiques de développement ? » ou « quelles sont les causes de la
pauvreté ? », pour aller vers des questions beaucoup plus précises avec, du
coup, la possibilité d’y apporter des réponses plus précises et donc plus
utiles. Il s’agit d’une rupture méthodologique par rapport à ce qui se
pratique communément dans ce domaine.
Lire aussi Esther Duflo ou l’ambition de faire quelque chose d’utile
<https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/03/esther-duflo-ou-l-ambiti...
Par exemple, l’un des premiers sujets sur lesquels nous avons travaillé est
l’éducation, car nous savons que les pays où le capital humain est
important croissent plus vite. Mais l’économiste ne peut pas se contenter
de dire à un gouvernement qu’il doit éduquer sa population. Il doit
répondre à des questions plus précises : comment faire pour que les enfants
aillent à l’école ? Mais cela ne suffit pas non plus : comment faire pour
qu’ils y apprennent quelque chose ? Quelle organisation, quels moyens
permettent d’y parvenir ? Et, plus précisément encore, faut-il diminuer le
nombre d’élèves par classe ? Faut-il plus de livres, de tables, de
cahiers ? Il se trouve que sur ces deux sujets les expériences que nous
avons menées ont contredit les croyances.
Nous avons pris des échantillons significatifs d’écoles, que nous avons
réparties en deux groupes. Dans les unes, on a fortement réduit la taille
des classes, mais pas dans les autres. C’est comme pour les essais
cliniques de médicaments, où le groupe test bénéficie d’un traitement, mais
pas le groupe témoin. On peut ainsi comparer les résultats, au bout d’une
certaine période. Ces groupes sont composés de manière aléatoire sur des
échantillons suffisamment grands pour qu’il soit possible d’en tirer des
conclusions. Certes, on laisse au passage beaucoup d’autres questions qui
ne sont pas traitées, mais on récolte au moins deux informations utiles :
1) est-ce que réduire la taille des classes améliore ou pas les résultats
scolaires ? 2) est-ce que les difficultés scolaires viennent d’autres
difficultés que la taille des classes ?
Apprenez, comprenez, mémorisez — Offrez-vous dix minutes par jour de
plaisir cérébral et approfondissez vos connaissances.
Testez gratuitement
<https://www.lemonde.fr/memorable/?rfextension=LM_SNIPV1>
Nos recherches permettent ainsi de comprendre ce qui marche et ce qui ne
marche pas, mais aussi d’accumuler brique après brique des éléments de
connaissance. Quand on accumule des dizaines, des centaines d’expériences,
on commence à dessiner une image plus globale de la façon dont ça
fonctionne, et de ce qu’il faudrait changer. C’est beaucoup plus efficace
que d’élaborer une politique à partir de grands principes.
Et, en l’occurrence, qu’ont donné vos expériences sur la taille des classes
et les moyens supplémentaires ?
Que ça n’avait aucun effet sur la performance moyenne des élèves… Idem sur
la distribution de manuels. Dans les deux cas, ce sont les bons élèves qui
en profitent le plus. Nous avons constaté que le problème venait plutôt de
la pédagogie. Dans les pays qui ont été colonisés, les programmes scolaires
sont demeurés très élitistes du fait de l’héritage de systèmes dont le but
était de former une minorité de personnes pour faire fonctionner
l’administration. Cette situation, qui conduit par exemple en Inde à
maintenir des manuels scolaires en anglais, alors que ce n’est que la
troisième langue du pays, est très excluante et peut expliquer que beaucoup
d’enfants décrochent.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi Esther Duflo, un choix inédit
pour le Nobel d’économie 2019
<https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/15/esther-duflo-un-choix...
Des programmes d’enseignement ciblé sur les élèves en difficulté, pendant
une partie de la journée ou de l’année, à l’école ou hors du cadre
scolaire, permettent de corriger cette situation – en anglais : *teaching
at the right level*. Nous l’avons constaté en Inde, où ces programmes de
soutien, d’abord lancés en coopération avec l’ONG Pratham, sont maintenant
généralisés dans plusieurs Etats et concernent près de 5 millions d’élèves.
Notre projet est d’étendre cette approche en Afrique. Une première
expérience a déjà été menée au Ghana.
Le plus difficile est d’identifier les moyens qui permettent au corps
enseignant et à toutes les personnes qui doivent contribuer à la mise en
œuvre des programmes de s’approprier ce qui leur est proposé. On ne peut
dire simplement : « C’est comme cela qu’il faut faire. » Il faut une
implication du haut de la hiérarchie. Il n’y a d’effets massifs que s’il y
a un relais institutionnel, une implication du gouvernement, mais celle-ci
doit descendre jusqu’à son incarnation locale : les vraies décisions sont
locales. C’est à ce niveau que nous travaillons.
Certaines idées reçues continuent de façonner les politiques de lutte
contre la pauvreté, quelle est la plus dommageable selon vous ?
L’une des plus répandues est qu’aider les gens les rendrait paresseux et
les encouragerait à profiter du système. Tous les dispositifs d’aide aux
plus pauvres, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays en
développement, sont construits sur cette croyance et possèdent de ce fait
une dimension punitive. Or nos expériences montrent que c’est le contraire
qui est vrai : plus on aide les gens, plus ils sont capables de repartir
d’eux-mêmes, plus ils sont aptes à sortir de la trappe à pauvreté dans
laquelle ils étaient enfermés.
Le programme mené au Bangladesh par l’ONG Bangladesh Rural Advancement
Committee (BRAC), qui a consisté à allouer aux plus pauvres un capital sous
la forme de quelques animaux ou d’un pécule permettant de commencer un
petit business tout en les accompagnant pendant dix-huit mois, en a fait la
démonstration. Il a été répliqué et évalué dans six autres pays et cela a
conduit aux mêmes conclusions. Une proportion importante de bénéficiaires
sont sortis durablement de la pauvreté ; ils sont en moyenne 30 % plus
riches, en meilleure santé, mieux éduqués ; en pouvant nourrir leur
famille, ils ont aussi reconquis une position de dignité dans leur
communauté. Aujourd’hui, une quarantaine de pays ont institutionnalisé ce
mode de transferts, en réunissant des consortiums de donneurs privés.
Lire aussi Le Nobel d’économie à Esther Duflo, Michael Kremer et Abhijit
Banerjee pour leurs travaux sur la lutte contre la pauvreté
<https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/14/le-nobel-d-economie-a...
Une autre expérience, au Ghana, proposait à deux groupes de travailler à la
fabrication de pièces textiles, mais seul un des deux groupes recevait en
plus une aide financière. Ce sont eux qui se sont avérés plus productifs et
plus efficaces, car le pécule les mettait à l’abri des autres
préoccupations que devait affronter le groupe témoin : se soigner, payer
l’éducation des enfants, etc.
Pour lutter contre l’extrême pauvreté, il faudrait donc d’abord changer
d’attitude à l’égard des populations concernées ?
Oui, il faut cesser de se méfier des pauvres. Avec Abhijit Banerjee, nous
proposons la création dans les pays pauvres d’un revenu universel « ultra
basique » qui permette d’assurer à toute personne un seuil de revenus
au-dessous duquel il ne pourra pas tomber, permettant de se nourrir, de se
loger. Et cela sans contrepartie.
Et pourquoi pas dans les pays riches ?
Cela coûterait très cher, car la définition d’une « vie digne » n’est pas
qu’une question d’argent, mais de place dans la société. Un tel revenu de
base ne peut pas être universel, mais ciblé en fonction d’un objectif,
permettre à chacun de jouer son rôle dans la société.
L’aide internationale au développement devrait-elle financer ce revenu
universel ?
Dans les pays fragiles ou en conflit, cela me paraîtrait assez justifié que
l’aide soit en partie utilisée pour cela. Il faudrait commencer par mettre
en place des infrastructures qui permettent de transmettre facilement de
l’argent aux personnes. Les nouvelles technologies – par le biais des
téléphones mobiles par exemple – rendent cela possible dans de nombreux
pays. Ces dispositifs pourraient s’avérer très utiles dans les cas de crise
ou de précrise (sécuritaire, agricole, climatique…) pour éviter que la
situation de se détériore davantage pour les plus démunis. La prévention
des conflits doit être une priorité de l’aide ; elle doit donc être en
mesure d’apporter des réponses dans l’urgence.
Quelle autre priorité attribuez-vous à l’aide ?
Il me semble que l’aide devrait accompagner les gouvernements dans la
recherche d’innovations sociales qui permettent de faire réellement la
différence en matière de développement dans la durée. Saucissonner le
financement entre des projets successifs adoptés au coup par coup ne sert
pas à grand-chose. Construire trente écoles ne rime à rien s’il n’y a pas
derrière une vision plus globale de l’éducation.
Le prix Nobel a été jusqu’ici le plus souvent attribué à des économistes
américains âgés, et plutôt pour la « beauté » de leurs modèles théoriques
macroéconomiques. Que signifie pour vous l’attribution du Nobel 2019 à une
femme, jeune, française, adepte d’une approche expérimentale et
microéconomique ?
Ce prix Nobel reflète l’évolution très rapide du travail en économie du
développement, qui est de fait devenu de plus en plus expérimental. Mais
cette évolution ne s’est pas faite de façon isolée de l’avancée d’idées
économiques plus globales.
Le prix est collectif, il a été décerné à trois personnes, toutes membres
du Poverty Lab : Michael Kremer, le premier qui a pensé et démontré que
l’on pouvait faire des expérimentations de terrain robustes peu coûteuses
et rapides ; Abhijit Banerjee, fondateur du laboratoire, a montré que ces
méthodes d’expérimentation permettaient non seulement d’évaluer les
politiques publiques, mais aussi de changer la façon même de faire de
l’économie. Lorsqu’on ne peut pas mener d’expériences, construire et
adapter les modèles économiques devient la principale activité des
économistes. Nous avons créé un outil qui permet de tester toutes les
hypothèses, de formuler de nouveaux modèles à partir des résultats de
l’expérience.
Nous ne nous contentons pas de mener des micro-expériences dont les
résultats ne seraient valables que dans le temps et le lieu où elles se
sont déroulées : ils sont généralisables. En pratique, si on trouvait des
résultats différents à chaque expérience, je comprendrais la critique. Mais
ce n’est pas le cas ! Nos expériences de lutte contre l’ultrapauvreté
montrent toutes que cette aide est efficace ; de même toutes nos
expériences sur le microcrédit montrent que ça ne marche pas… Cela ne veut
pas dire que le microcrédit ne marchera pas un jour, quelque part, mais
pour l’instant nos expériences ne le montrent pas.
Le Poverty Lab a mené et mène des milliers d’expérimentations dans le
monde. Nous sommes 200 chercheurs à y travailler, plus 200 *fellow
travellers*, c’est-à-dire des collègues associés dans d’autres laboratoires
qui appliquent nos méthodes sur le terrain. Nous travaillons, bien plus
collectivement que la plupart des économistes. En cela, le Nobel récompense
et encourage, au-delà de nos trois personnes, un véritable mouvement, sans
lequel cette science ne pourrait pas se construire.
Si on ne pouvait pas tirer de conclusions générales de toutes ces
expériences cumulées, il n’y aurait pas de politique possible ! Si je
pensais cela, je ne pourrais pas me lever le matin…
Pour vous, l’économie est une science, une science expérimentale ou une
science sociale ?
L’économie est le travail que font les économistes, ce débat me semble
inutile. Il y a toujours eu, en économie comme ailleurs, des allers-retours
entre la recherche de principes et la vérification empirique de ces
principes. L’idée que la science économique puisse se passer de
vérifications a pu exister chez certains économistes. Mais les hypothèses
sur lesquelles sont construits leurs modèles sont de moins en moins
robustes au fil du temps.
Les économistes ont sans cesse tenté de les interroger par des méthodes
diverses : l’économétrie d’abord, les expériences naturelles ensuite.
L’étape suivante est celle que nous pratiquons, appelée dans notre jargon
« évaluation par échantillonnage aléatoire » (*randomized controlled
trials, *RCT), où l’on « crée » des expériences naturelles, qui sont ainsi
plus faciles à contrôler. C’est cela qui change radicalement la façon de
faire de l’économie.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi « L’inégalité est idéologique et
politique » : les extraits exclusifs du nouveau livre de Thomas Piketty
<https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/04/l-inegalite-est-ideol...
quoi servent les économistes ?
Certainement pas à prévoir quoi que ce soit… Ils sont utiles comme des
plombiers, pour analyser des problèmes spécifiques et proposer des
solutions qui marchent. J’ai fait de l’économie parce que je voulais être
utile pour la cité, en m’impliquant dans le détail de la vie en société.
Certains économistes vous reprochent, en vous contentant de ces
micro-expériences, de perdre de vue la « Big Picture », de négliger le rôle
essentiel des institutions et de leur réforme indispensable pour rendre les
politiques efficaces. Que leur répondez-vous ?
Je ne pense pas qu’il faut faire la révolution pour pouvoir changer les
choses. Il y a beaucoup de solutions qui marchent sans avoir à changer les
institutions. On ne peut pas faire grand-chose pour empêcher et prévoir les
coups d’Etat, les conflits armés, mais on peut quand même faire quelque
chose pour améliorer la vie des gens. Autrement, c’est se laisser aller à
la politique du pire. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de difficultés
pratiques à mener de telles interventions (la corruption, les blocages
institutionnels, les rivalités politiques) mais ma philosophie est qu’il
faut agir quand même. J’ai de l’espoir, et il y a des raisons d’être
optimiste.
Tout empire dans le monde, surtout en ce moment, mais pas la pauvreté. Le
nombre d’ultrapauvres a été divisé par deux, la mortalité infantile aussi.
C’est l’effet de facteurs que l’on ne contrôle pas (la mondialisation des
échanges, les prix de marché des ressources naturelles) mais aussi d’une
approche plus pragmatique des questions de santé, d’éducation, des
programmes sociaux : la pauvreté a enfin été considérée comme un problème à
résoudre, et pas seulement comme une conséquence.
Par exemple, on a réduit de 450 000 le nombre de cas de paludisme dans le
monde en distribuant gratuitement des moustiquaires, grâce aux expériences
randomisées de ma collègue Pascaline Dupas *[prix du meilleur jeune
économiste 2015]* qui ont montré que la gratuité était plus efficace que *« le
juste prix »*préconisé par de nombreux économistes.
Article réservé à nos abonnés Lire aussi L’incroyable succès des
économistes français aux Etats-Unis
<https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/04/l-incroyable-succes-d...
débat suscité par les travaux de Thomas Piketty, d’Emmanuel Saez, de
Camille Landais et de Gabriel Zucman sur les inégalités aux Etats-Unis, où
ils enseignent dans les plus prestigieuses universités, leur influence sur
le programme de la candidate démocrate Elizabeth Warren, et maintenant
votre prix Nobel… Diriez-vous qu’il y a une « école française »
d’économistes aux Etats-Unis ?
Les travaux de Thomas Piketty et de ceux qu’il a inspirés ont été publiés
au moment où la gauche américaine s’interrogeait : à quel moment avons-nous
raté le coche du décrochage des classes moyennes qui nous soutenaient ? Ces
travaux d’économistes engagés à gauche apportent une réponse. Leur succès
public est dû au fait qu’il y a une manière bien française de faire de
l’économie : contrairement à mes collègues américains, qui ne publient pas
ou peu de livres, le plus souvent à la fin de leur carrière, les
économistes français publient volontiers des livres accessibles au public.
Laurence Caramel
<https://www.lemonde.fr/signataires/laurence-caramel/>et Antoine
Reverchon <https://www.lemonde.fr/signataires/antoine-reverchon/>